« Migrations postcoloniales des Juifs du Maroc » : de Casablanca à Montréal, une mémoire en mouvement
Ils sont partis dans l’urgence, parfois dans la peur, souvent sans les mots pour dire l’arrachement. À la sortie de la Shoah, dans le sillage immédiat de la création de l’État d’Israël en 1948 et tandis que l’empire colonial français se défait, près de 250 000 Juifs quittent le Maroc en l’espace de deux décennies. Longtemps réduit à une lecture strictement coloniale, cet exode révèle en réalité un espace migratoire bien plus complexe, façonné par des espoirs déçus, des discriminations persistantes et des décisions prises sous la contrainte des contextes politiques, sociaux et économiques.
Israël, la France, mais aussi le Québec s’imposent tour à tour comme les pôles de ces trajectoires fragmentées. Dans Migrations postcoloniales des Juifs du Maroc. Vers le Canada et la France, Yolande Cohen propose une synthèse majeure de ces parcours durablement relégués aux marges des récits officiels, en les replaçant dans le fil de l’histoire récente. « Il faut sortir d’une lecture simpliste des départs et comprendre que ces migrations s’inscrivent dans une vision beaucoup plus large et plurielle » , explique l’historienne en entrevue téléphonique.
Professeure titulaire d’histoire contemporaine à Université du Québec à Montréal (UQAM), Yolande Cohen voit dans cet ouvrage collectif, qu’elle a dirigé, un véritable aboutissement. Fruit de plus de dix ans de travail mené avec une équipe pluridisciplinaire, le livre marque un tournant dans son parcours. « Je suis sortie de l’aspect entièrement subjectif pour aller vers des subjectivités partagées » , souligne-t-elle, insistant sur la richesse d’un regard construit à plusieurs voix.
Le livre rassemble ainsi une sélection de textes d’abord publiés dans des revues scientifiques, que l’historienne a souhaité rendre accessibles à un public plus large. L’ensemble s’attarde sur une dimension encore peu explorée de l’histoire singulière d’une diaspora, celle des Juifs marocains, souvent éclipsés par la visibilité des communautés ashkénazes, issues d’Europe centrale et orientale. Il met en lumière la diversité de ce groupe, sa réinvention au fil du temps et son profond enracinement au royaume chérifien. « La rupture avec le Maroc n’a jamais été une rupture affective » , rappelle-t-elle, soulignant combien la marocanité demeure une composante intime de l’identité, transmise de génération en génération. « Il faut sortir d’une lecture simpliste des départs et comprendre que ces migrations s’inscrivent dans une vision beaucoup plus large et plurielle. » Yolande Cohen
Parmi les apports majeurs de l’ouvrage figure le recours assumé aux témoignages et à l’histoire orale. Longtemps reléguée à la marge du champ universitaire, cette approche devient ici un outil central pour comprendre les migrations, en donnant accès aux récits de vie et aux perceptions que les archives administratives laissent dans l’ombre. « Sur des sujets où l’on étudie les perceptions, l’intersubjectivité est fondamentale » , rappelle Yolande Cohen, attentive aux silences, aux hésitations et aux non-dits qui traversent la mémoire migrante.
La lecture postcoloniale irrigue l’ensemble des chapitres. Les départs massifs des Juifs marocains ne sauraient se réduire ni à un simple attrait pour l’Occident ni à un sionisme uniforme. Israël, destination majeure des premières vagues, fut aussi un espace de désillusion, marqué par de fortes discriminations envers les Juifs nord-africains. La France, pour sa part, refusa largement d’accorder la nationalité à cette population, révélant la persistance des hiérarchies héritées de l’ordre colonial. « Tout cela se savait » , observe l’historienne. Dans ce contexte, le Québec s’impose comme une issue inattendue au sein de l’Amérique francophone.
Au Québec, la construction d’une identité sépharade
Dans les années 1960 et 1970, les Juifs marocains sont accueillis au Québec comme des réfugiés francophones. Le soutien logistique des institutions juives ashkénazes joue un rôle décisif, même si l’intégration n’est pas exempte de tensions. La question linguistique devient centrale. Alors que la communauté juive établie est majoritairement anglophone, les nouveaux arrivants revendiquent une insertion en français, dans le contexte de l’éveil du nationalisme québécois. « De cette friction naissent la Communauté sépharade du Québec puis l’école Maïmonide, la seule école juive francophone en Amérique du Nord » , souligne Yolande Cohen. Un moment structurant pour la consolidation d’une minorité juive francophone.
L’essai s’articule autour de la notion de « champ migratoire » , qui rompt avec une vision figée de l’immigration. Les trajectoires ne suivent pas une ligne droite, mais dessinent un espace de circulations constantes entre le Maroc, Israël, la France et le Québec. « Il y en a beaucoup qui viennent d’Israël, ils sont passés par là, ont été déçus et viennent ensuite au Québec » , note l’historienne. Cette logique de déplacements successifs traverse d’ailleurs aussi son propre parcours.
Née en 1950 à Aubagne, près de Marseille, Yolande Cohen n’y passe que ses trois premières années. Elle découvrira bien plus tard qu’elle avait vécu dans un camp de transit, où séjournaient des Juifs marocains en attente d’un départ vers Israël. La guerre qui éclate dans le jeune État hébreu pousse ses parents à renoncer à ce projet et à retourner au Maroc, où elle grandit. Étudiante à Paris, elle rejoint finalement ses parents à Montréal en 1976, après leur immigration au Canada.
Cette mobilité révèle une histoire faite de réajustements, de renoncements et de recompositions identitaires. « Le Québec apparaît comme une porte de sortie » , observe-t-elle, un territoire d’Amérique perçu à l’époque comme un espace de possibilités, où l’on promettait des papiers, du travail et une intégration rapide.
Si l’accueil institutionnel fut réel, notamment grâce au soutien des organisations juives et à l’ouverture du gouvernement québécois à une minorité francophone non catholique, les tensions autour de la langue, de la religion et de la reconnaissance n’ont jamais totalement disparu. « On a tendance à penser que notre système est plus juste ou plus inclusif, mais chaque modèle a ses zones d’ombre » , précise l’historienne.
Elle estime que « les promesses d’émancipation s’avèrent parfois incomplètes » , soulignant combien l’antisémitisme et le racisme anti-maghrébin continuent de fragiliser l’idéal d’égalité. Son analyse met par exemple en évidence les limites du modèle français, fondé sur une laïcité fortement intégratrice qui encadre les religions minoritaires par des consistoires, laissant peu d’espace à l’expression autonome des communautés. « À l’inverse, le multiculturalisme canadien et l’interculturalisme québécois leur accordent une place plus large, parfois au détriment de la reconnaissance de leur apport singulier au récit collectif. » Montée de l’antisémitisme
Même si l’essai ne se penche pas directement sur la communauté sépharade contemporaine, il met en lumière l’ampleur des transformations qu’elle a connues au cours des 20 dernières années. À Montréal, cette communauté, longtemps marquée par une forte laïcité et une affirmation francophone, se trouve aujourd’hui à un moment charnière, affirme l’historienne. « Le mouvement semble s’être inversé, avec une montée de la religiosité, un repli identitaire et une adhésion plus exclusive à Israël. » Ces recompositions internes ne peuvent être dissociées du contexte actuel. Depuis le 7 octobre 2023, la résurgence de l’antisémitisme agit comme un révélateur. Au Québec, où la population juive est moins nombreuse et moins visible qu’en France, cette hostilité demeure plus diffuse, mais bien réelle. Elle met en lumière une fragilité identitaire particulièrement perceptible chez les Juifs marocains de Montréal, dont l’histoire migratoire reste encore insuffisamment connue et assumée. « Cette pression extérieure tend aussi à estomper les clivages entre sépharades et ashkénazes au profit d’un front commun. Les communautés ont besoin de structures de défense partagées » , souligne-t-elle.
Il reste que, sur le plan socio-économique, l’intégration a été rapide, notamment pour les femmes, nombreuses à investir les réseaux de l’enseignement et de la fonction publique. Mais l’identité demeure un chantier fragile. Juifs marocains, sépharades, juifs francophones, les catégories se succèdent sans jamais se stabiliser pleinement. « Il y a des traumatismes liés au départ qui n’ont jamais été formulés » , observe l’historienne. « La migration du Maroc fut celle de réfugiés qui ne furent jamais reconnus comme tels, contraints d’abandonner en quelques années une terre ancestrale et un mode de vie millénaire. » À l’heure où le Québec s’interroge à nouveau sur son modèle d’intégration, sur la place du religieux dans l’espace public et sur la transmission des mémoires minoritaires, le travail de Yolande Cohen apporte des éléments de réflexion précieux. En invitant la communauté juive marocaine à se confronter à ses silences et à ses traumatismes de l’exil, l’historienne rappelle que l’histoire ne se limite pas à un récit du passé. « Si on ne sait pas d’où l’on vient, on ne sait pas où l’on va » , conclut-elle.
Source de l’article : Le Devoir
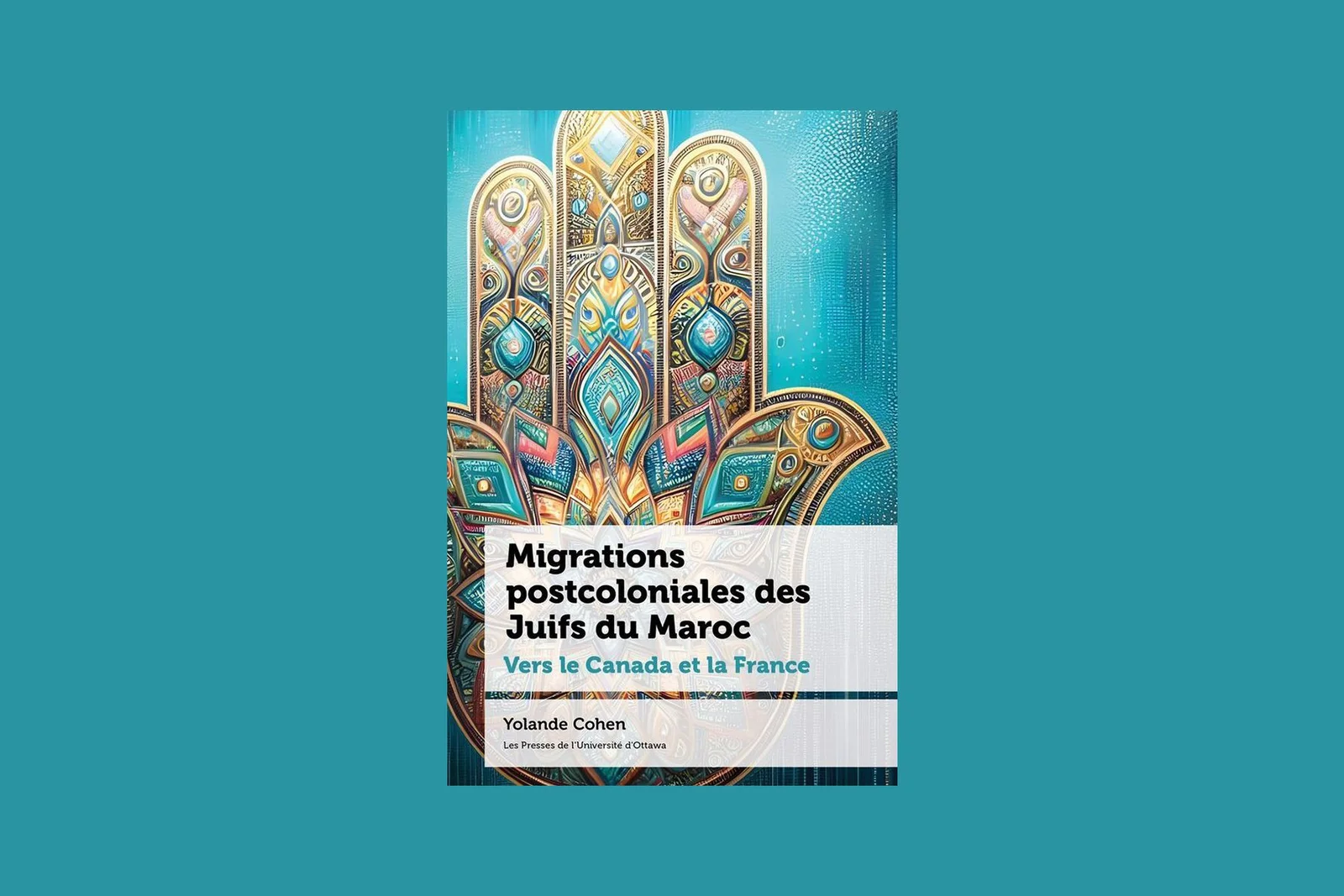
















Laisser un commentaire