L’incroyable destin de Farah Pahlavi, la dernière impératrice d’Iran
Farah Pahlavi, que les Français connaissent aussi sous son nom de jeune fille Farah Diba, fut, de 1959 à 1979, la dernière impératrice d’Iran. Sa beauté, sa jeunesse, son rôle de mère modèle, sur fond des fastes de la cour, firent de cette jeune fille francophone, éduquée notamment au lycée français de Téhéran et marqué par le scoutisme, l’une des plus grandes sensations médiatiques de son temps. Digne d’une Jacqueline Kennedy comme d’une Lady Diana, rien ne prédestinait pourtant Farah Diba à devenir impératrice et, à bientôt 90 ans, à se retrouver à nouveau en prise avec les secousses de l’histoire, et celles que beaucoup considèrent aujourd’hui, alors que le régime iranien vacille dans un déchaînement de violence, celle que certains considèrent « la mère du pays » .
Farah Diba est la troisième épouse du dernier Shah d’Iran, représentant de la dynastie des Pahlavi arrivée sur le trône en 1925. Issue d’une ancienne famille — un de ses grands-pères avait été ambassadeur de Perse en Russie –, orpheline de père à dix ans, cette fille unique sportive (elle excelle en basket) se destine d’abord à devenir architecte. Comme beaucoup d’enfants de la bonne société iranienne, c’est en France qu’elle vient faire ses études : elle réside à la Cité Universitaire, dans le sud de Paris, quand elle rencontre le Shah, venu de son côté voir le Général de Gaulle, à la faveur d’un événement le réunissant avec les étudiants iraniens. « La prestance et le maintien d’une impératrice » À l’automne 1959, Farah Diba se fiance, en robe Dior, et s’apprête non seulement à devenir la troisième épouse du Shah (il a divorcé de Faouzia d’Egypte onze ans avant, et vient de quitter la Chahbanou Soraya avec qui il ne pouvait pas avoir d’enfants : un deuxième divorce pour raison d’État). Même le journal Le Monde, peu porté sur les royals, témoigne de ce moment : Farah « n’était plus l’adolescente timide qui, le 11 octobre, faisait renouveler ses inscriptions à l’École spéciale d’architecture de Paris. Farah, transformée par les bonnes fées de la mode parisienne, avait déjà la prestance et le maintien d’une impératrice au moment où elle gravit le perron du palais » . Le mariage, célébré le 21 décembre, est un événement suivi par le monde entier : Farah Diba se marie là aussi en Dior, dans une tenue dessinée par un certain Yves Saint Laurent. La cérémonie de mariage organisée au Palais de Marbre Vert est, comme en témoigne Le Monde, plutôt modeste : même les arches dressées dans la rue sont celles mise en place pour la récente visite du président américain… mais 2000 invités de haut rangs s’y pressent quand même.
Quatre jours de festivités organisées à la mi-octobre 1971 réunissent à Persépolis, dans un campement de 64 hectares imaginé pour l’occasion, des dizaines de chefs d’États, le prince Philip et sa fille la princesse Anne. Orson Welles en personne assure la traduction du discours du Shah. Pour le banquet du 14 octobre, donné en l’honneur des 33 ans de l’Impératrice, le restaurant Maxim’s de Paris est à l’œuvre avec, selon le New York Times, un menu comprenant des « perdrix farcies au foie gras et à la truffe, accompagnées d’une sélection de vins allant du Dom Pérignon rosé au Château Lafitte du vignoble Rothschild » . Titre de l’article ? « Une nuit persane de Rois, de Reines, de Sheiks, de Sultans et de diamants » . Des voix s’élèvent pourtant pour dénoncer l’autoritarisme du régime et les dépenses exorbitantes. L’imam Khomeini persifle : pour l’opposant exilé, il s’agit rien de moins que du « Festin du diable » . « Le Shah ne renonce pas » Farah Pahlavi mène, dans les années suivantes, la vie classique d’une épouse de chef d’État. Quand elle n’est pas en visite officielle avec tout ce que cela impose de protocole, elle s’implique dans le développement du droit des femmes et des initiatives culturelles, son pouvoir étant inexistant côté politique. En matière de santé, elle préside le Congrès médical iranien, assure le patronnage de la Société nationale de lutte contre le cancer, de l’association pour le sauvetage des brûlés, ou encore de la Fondation iranienne pour la santé mondiale. Farah Pahlavi fonde l’Orchestre symphonique de Téhéran, l’un des plus remarquables des années 1960, et le festival des arts de Chiraz-Persépolis, seule manifestation d’art contemporain du pays. Versée dans la culture, son cabinet négocie l’achat d’oeuvres de Jackson Pollock, Paul Gauguin, Monet, pour les musées qui s’ouvrent alors à Téhéran.
En vacances, Farah Pahlavi consent à être prise en photo, et en famille, pendant ses séjours au ski à Saint Moritz, sur fond de balade en calèche sur les pistes enneigés. Pourtant, derrière ces fastes officiels, une page est en train de se tourner. Corruption, opposition des mollahs, autoritarisme du système, rapprochement avec la Chine qui fait sourciller l’allié américain : les jours du régime sont comptés alors que les années 1970 touchent à leur fin. Dans le palais de Niavaran, tout est fait pour préserver la vie de famille. Les blindés veillent autour. « Le Shah ne renonce pas » , titre Paris Match le 19 janvier 1979. Trois jours avant, il a pourtant quitté le pays avec son épouse. Ni lui, ni elle ne remettront les pieds en Iran. Ni les enfants, dont les deux ainés ont été envoyés de manière préventive aux États-Unis.
Les douleurs de l’exil
S’ensuit pour Farah Pahlavi, son époux et leurs quatre enfants une longue errance. Égypte, Maroc, Mexique, Floride… Le Shah apparaît amaigri : il est atteint d’un cancer depuis quelques années, et la situation se détériore. En Iran, le souverain est condamné à mort. L’errance se poursuit : sur fond de crise des otages américains à Téhéran, il faut quitter les États-Unis, direction le Panama, puis l’Égypte. Le Shah s’y éteint le 27 juillet 1980. Il avait soixante ans. Pour son épouse et leurs quatre enfants, la vie se déroulera désormais entre la France et les États-Unis. Reza Pahlavi, qui a prêté serment le 31 octobre 1980 au palais de Koubbeh au Caire, entame un parcours qui le mènera, finalement, à un diplôme de l’université de Californie du Sud et se marie en 1986 avec une exilée iranienne, avec qui il aura trois filles. Le destin de sa soeur Leïla sera beaucoup plus tragique. Exilée à l’âge de neuf ans seulement, elle ne se remettra jamais de ce départ forcé. Après une vie faite de voyages, un passage à l’université Brown et une brève carrière de mannequin qui la propulse au rang d’icône mode, Leïla Pahlavi est retrouvé morte dans une chambre du Leonard Hotel de Londres le 10 juin 2001. Elle avait 31 ans.
La peine, pour Farah Pahlavi, est immense. « C’est très dur. C’est normal, tous les jours j’y pense. Je me dis : j’aurais du faire ceci, cela. Et puis je me dis : bon, c’est fini, on ne peut pas retourner en arrière, et il faut aller de l’avant pour les autres enfants, pour les petits-enfants… Mais je ne peux pas m’empêcher d’y penser, parce que Leïla était une fille tellement intelligente, tellement belle et tellement sociable. Elle avait tellement de projets. Peut-être était-ce la perte de son pays, la perte de son père, la situation où nous avons été au début de l’exil, nous d’un côté, les enfants de l’autre… » explique-t-elle, très émue, sur le plateau de la journaliste Mireille Dumas en avril 2007. Quatre ans après, c’est au tour de son second fils, Ali Reza, de se donner la mort à Boston à l’âge de 41 ans. « Ne pas perdre sa propre dignité » « La vie est une lutte pour tout le monde, à n’importe quel niveau. On peut perdre son pays, on peut perdre ses êtres chers, on peut perdre sa position, ses possessions, mais il ne faut pas perdre sa propre dignité » , affirme Farah Pahlavi, toujours en 2004. Cette femme au destin inimaginable, passée par les plus grands fastes et les plus grandes douleurs que la vie puisse offrir, est à 87 ans un symbole pour les millions d’Iraniens en exil, mais aussi pour certains des 90 millions de citoyens du pays. À l’heure de ce qui ressemble, de près, à une révolution, où le régime vacille plus encore que lors des précédents mouvements populaires (on pense notamment au mouvement Femme, vie, liberté de 2022), une chose jusque là inouïe se produit : on scande, dans le rues de Londres comme celles de Téhéran, le nom de Pahlavi.
Farah Diba est considérée par certains comme la « mère du pays » . Suivie par des millions d’abonnés sur Instagram et Twitter, elle a publié sur le site de sa fondation, quelques jours après le début des émeutes, un communiqué intitulé « La Lumière prévaudra sur l’obscurité » . Farah Diba y écrit notamment à ses compatriotes iraniens : « Votre combat n’est pas vain. Ce moment vous appartient. Il restera dans les mémoires comme un tournant décisif, celui où le peuple iranien a repris son avenir en main. J’appelle les forces de sécurité à se joindre au peuple dans ce mouvement. » Elle sait qu’aujourd’hui beaucoup de regards sont tournés vers un homme : son fils Reza, même si un potentiel retour au pouvoir des Pahlavi est encore très lointain.
Reza Pahlavi, activiste sur les réseaux sociaux
Celui-ci, qui s’est longtemps engagé en faveur du retour de la monarchie en Iran, porte aujourd’hui un discours plus modéré. Très actif sur les réseaux sociaux, il se présente à ses 9 millions d’abonnés sur Instagram comme un « militant pour une démocratie séculaire en Iran » . Son message partagé le 7 janvier, alors que la manifestation, comme la répression, s’intensifiait, a obtenu près de 2 millions de like, et chacune de ses vidéos est vue des millions de fois.
Instagram content
Mais ce personnage proche des conservateurs – en février dernier, il était avec Giorgia Meloni, Elon Musk et Steve Bannon à la grand messe de la conférence de la CPAC – et ne semble pas faire l’unanimité. Même Donald Trump reste prudent : « Je l’ai observé et il semble être quelqu’un de sympathique. Mais je ne suis pas sûr qu’il soit approprié à ce stade de faire cela en tant que président. Je pense que nous devrions laisser tout le monde se présenter et voir qui se démarque » , a-t-il déclaré lors d’une interview avec le journaliste américain Hugh Hewitt. Reza Pahlavi a également soutenu l’idée d’une intervention du gouvernement américain contre le régime iranien qui, pour l’instant, ne semble pas à l’ordre du jour. « Imposteur providentiel » selon le journal Libération, l’homme semble surfer autant sur une vague nostalgique (la modernité d’une partie de la société iranienne du début des années 1970) que sur une position pro-américaine, visant, notamment, à reconnaître immédiatement Israël et à poursuivre les accords d’Abraham, qui deviendraient… les accords de Cyrus. Une position que les grands acteurs géopolitiques semblent, pour l’instant, observer avec distance cet homme sans expérience véritable ni organisation politique derrière lui. Mais l’homme est un symbole puissant. Et s’il devait, un jour, revenir en Iran, c’est sûrement aux côtés de sa mère Farah Pahlavi qu’il ne manquerait pas de s’afficher.
Source de l’article : Vanity Fair




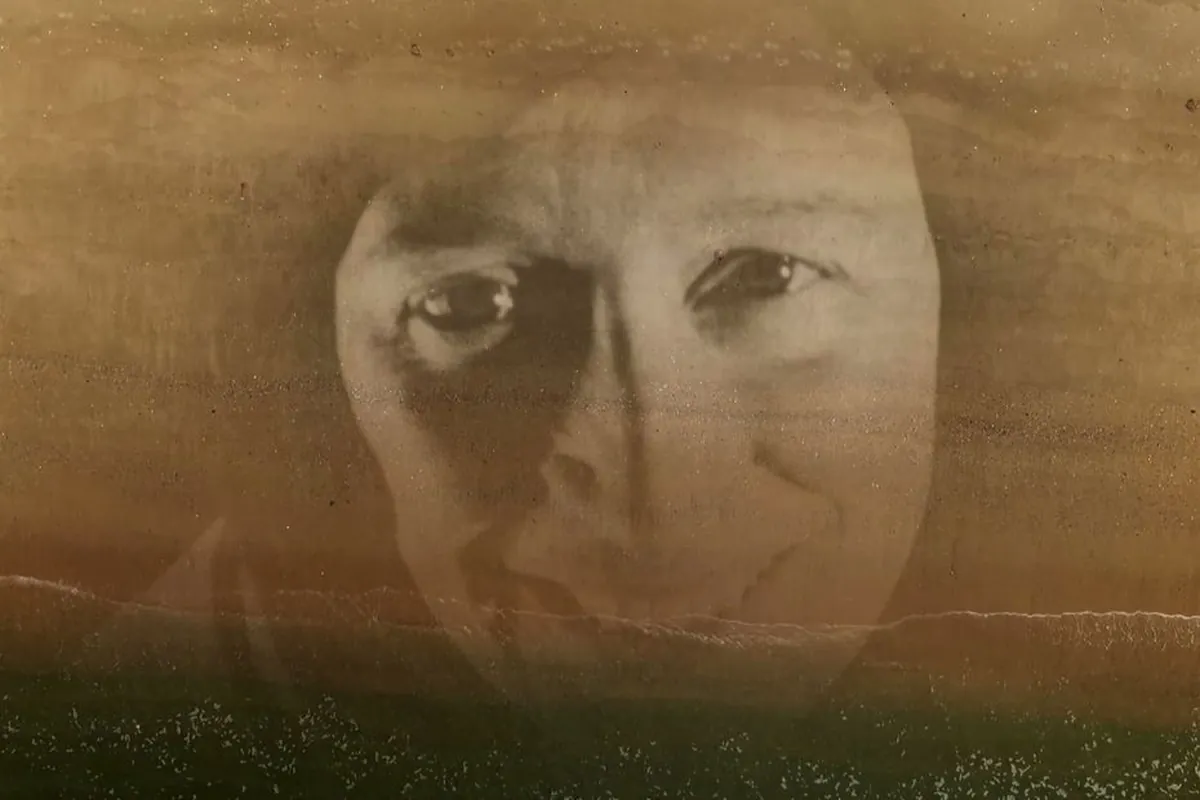












Laisser un commentaire